07 juin 2006
là où la vie emmure

Là où la vie emmure, l'intelligence perce une issue.
Marcel Proust, Le Temps retouvé (RTP, IV, 484)
01:00 Publié dans citations, conscience | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
06 juin 2006
l'exemple est la poésie
La préface se termine par une description de la nouvelle « économie » de la pratique et de l'échange de la poésie créée par internet :
L’exemple est la poésie, ou plutôt l’économie de la poésie. Ce précieux canton de l’activité humaine est en train de sortir du marché. De A à Z. Depuis le travail et le temps qu’il faut pour écrire jusqu’aux rencontres où les textes se partagent. Dans la poésie, dans l’économie de la poésie, toutes les crises dont ce texte a décrit le nœud trouvent comme une issue.
Crise du temps humain
La poésie ne rapporte pas d’argent, pas assez d’argent pour être une activité concurrentielle sur le marché du temps. Au regard du critère unique qui est l’augmentation du taux de profit, elle n’intéresse pas. Mais elle ne meurt pas pourtant. Elle vit. Elle vit fort. Elle fructifie dans le temps qu’on lui laisse, le temps gratuit, et dans la forme d’activité qui lui convient, la libre activité. Celles et ceux qui pratiquent l’art de la poésie vendent de leur temps, les pauvres. Il le faut bien. Par ailleurs. Pour pouvoir faire leur marché. Mais la poésie! Regardez-les, ces puissants forgerons. Ils repoussent à l’extrême de leurs forces les parois blindées du temps vendu et l’espace qu’ils dégagent grâce à ce repoussement, ils le magnétisent. Sans le dire et peut-être sans le savoir, ils rejoignent à leur façon le grand mouvement civilisateur engagé par la classe ouvrière pour la réduction du temps de travail vendu et «l’abolition du salariat», comme on disait naguère jusque dans les statuts de la CGT. Le temps gratuit du poète n’est pas vide. La poésie l’envahit et l’enchante. Le syndicaliste et le poète ont des choses à se dire.
Crise de l’échange
La poésie du temps gratuit s’échange. La poésie est occasion de rencontre et de partage. Elle ne s’échange pas comme une marchandise, parce qu’on ne sait même pas si on sera capable de la goûter. Parce que le poème s’inscrit toujours dans la singularité aléatoire de la rencontre. Il peut faire du bien, comme une canette de coca-cola glacé au midi d’un jour chaud peut, elle aussi, faire du bien. Mais contrairement à la canette de coca, la satisfaction qu’on attend du poème reste un mystère dont l’argent ne sera jamais la mesure. On en aura toujours trop ou trop peu pour son argent. La poésie n’est pas une marchandise. Les poètes et les amis de la poésie se transmettent les textes dans des réunions ou par Internet. Ils se les parlent. Ils les apprennent par cœur. Ils publient même et achètent aussi des livres, mais les éditeurs de poésie sont souvent des artisans, ouvriers d’une marchandise artisanale clairement subordonnées à son usage. Une marchandise honnête acceptant de se laisser déborder par son bel usage.
Crise de l’espace commun
Libérée de la double contrainte du pouvoir et du marché, la poésie prolifère et se dissémine. Son histoire s’est longtemps représentée comme un vecteur gradué, comme une course au podium: prix littéraires et chapitres calibrés dans les programmes scolaires. Désormais, il y en a trop. C’est statistique. Trop d’humains sachant lire et écrire. Trop envie de faire un tour dans les sentiers inexplorés du langage. Trop étroits, les podiums. On persiste à parler de littérature contemporaine ou d’histoire de l’art. On le fait avec l’innocence de croire à ces mots menteurs où il est impossible de faire entrer autrement qu’au brodequin de fer les lignées littéraires et artistiques extérieures au centre de l’empire occidental. Et quand ce traitement ne suffit pas, les arts non blancs sont déclassifiés en arts premiers ou en musique du monde. On est en train de construire un musée pour ça, quai Branly. Mais avec la poésie en réseau, en tissu, la généalogie impériale commence à vaciller. Le texte du chasseur-donso produit par oral dans des funérailles passe sa navette africaine entre les autres fils du tissu et ça rend bien. Dans le réseau des poésies croisées que délaisse le marché, l’espace commun s’établit et se ressent.
Crise du langage
Les privatiseurs de langage ont délaissé la forge où se travaillent les mots du poème. Rien à tirer de ça. Sans valeur. Champ libre pour la vérité.
Pas sérieux, la poésie? On peut le dire en effet, puisque la règle du sérieux et de l’important, l’étalon sur lequel tout semble devoir s’évaluer, c’est l’argent. Mais alors il faudra en dire autant pour l’amitié, la vie associative, l’amour, l’éducation nationale, la promenade en bord de mer ou dans le bois communal, la conversation, la sécurité sociale, le meeting politique, la prière, l’éclairage public, la lumière du soleil, la bibliothèque municipale, le soin des enfants, l’exercice du droit de vote, tous les biens produits par la libre activité, les grandes joies et les vraies mélancolies qui toujours se dissolvent à la perspective d’être mises en vente… Au fait, si je nous rappelle que la gratuité n’est pas à la périphérie de notre existence, mais qu’elle est en son axe, que le plus important dans nos vies n’est pas ce qui s’achète mais ce qui est sans prix, si j’en conclus qu’il est bon de donner davantage d’espace à cette gratuité axiale et de périphériser ce qui se vend, c’est une billevesée ou ça mérite qu’on creuse la question ?
Jean-Louis Sagot-Duvauroux, De la gratuité (Éditions de l'Éclat, 2006)
00:15 Publié dans internet, littérature, travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
05 juin 2006
le rêve de la gratuité
 Jean-Louis Sagot-Duvauroux, qui avait publié il y a quelques années Pour la gratuité (Belles lettres, 1995), propose aujourd'hui à nouveau ce texte, augmenté d'une longue préface intitulée « Rêves en crise », sous le titre De la gratuité.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux, qui avait publié il y a quelques années Pour la gratuité (Belles lettres, 1995), propose aujourd'hui à nouveau ce texte, augmenté d'une longue préface intitulée « Rêves en crise », sous le titre De la gratuité.
Ce livre est publié par les éditions de l'Éclat et disponible intégralement en ligne sous forme de lyber, excellent exemple de gratuité bien comprise, comme le souligne Michel Valensi, qui dirige les éditions de l'Éclat. Il est également l'un des rares éditeurs français à avoir « pactisé » avec Google et affirmait récemment dans Livre Hebdo (14 avril 2006, 641) en être très satisfait (les deux tiers des clics d'internautes se sont transformés en achat).
Sagot-Duvauroux, qui cite en exergue un propos récent du ministre français de la Culture : « J’ai en face de moi un ennemi redoutable, le rêve de la gratuité » (!), retrace avec clarté l'histoire, assez récente, de la propriété intellectuelle :
Penchons-nous donc sur cette propriété intellectuelle, victime tellement digne de compassion qu’on voit d’un même mouvement se lamenter sur elle Bouygues le bétonneur et la Société des Gens de Lettres, le doux rocker Francis Cabrel et Lagardère marchand de canons. Concrètement, elle apparaît dans le monde occidental, au XVIIIe siècle, sous la double forme du droit d’auteur et du copyright. L’un et l’autre englobent, dans un dosage différent, deux types de droits: un droit moral qui donne à l’auteur un certain nombre de prérogatives sur l’usage de ses œuvres; un droit patrimonial qui fait d’une production de l’esprit une marchandise protégée, négociable par ses ayant-droit. Cette innovation émerge en un temps où l’activité créatrice s’émancipe du pesant mécénat qui est jusque-là la principale source de revenus des auteurs sans fortune. En ouvrant aux créateurs une maîtrise mieux garantie sur l’usage de leurs œuvres et les moyens d’une existence plus autonome, elle constitue indéniablement une étape émancipatrice de l’histoire culturelle. Elle s’inscrit dans le mouvement général de libéralisation qui provoque alors l’essor de la société britannique, l’indépendance américaine, la révolution française.
Mais la forme prise par cette émancipation participe au match. D’abord, elle contribue à cristalliser une idéologie de l’œuvre et du génie qui marque une vraie bifurcation de l’histoire culturelle occidentale, imprimant son estampille sur la nature même des œuvres produites et sur leur relation à la société. Désormais, le génie créateur, de préférence solitaire, émet une œuvre dont une des qualités principales est de pouvoir prendre son autonomie, circuler, éventuellement entrer dans un processus industriel, par exemple l’imprimerie. L’œuvre est ainsi distinguée, séparée des rapports sociaux qui ont permis son émergence, fétichisée au sens où Karl Marx parle du fétichisme de la marchandise. Jusque-là, le commanditaire d’une œuvre – le pape de Rome pour Michel-Ange, le roi de France pour Molière, l’électeur de Saxe pour Jean-Sébastien Bach – en était l’ayant-droit légitime et le souverain ordonnateur. Désormais, c’est son auteur qui est élevé à la dignité de «propriétaire intellectuel», Prométhée à l’inspiration démiurgique qui peut garder son œuvre intacte dans le coffre à secret de son âme incomprise, ou la vendre au plus offrant. L’œuvre n’est plus le nœud d’une réunion circonstanciée où l’émotion collective d’une communauté humaine lui donne sens et vie – concours théâtraux de l’Athènes antique, soumou du Mali, féries religieuses de Pâques ou de Noël, bals princiers, oraisons funèbres. Elle est l’œuf inaltérable d’un aigle solitaire offert à l’adoration dévote des consommateurs de propriété intellectuelle. Elle est la forme sublime de la marchandise, son Saint-Sacrement.
[…]
Les lignées occidentales de la vie artistique se débattent aujourd’hui dans des controverses dépressives qui amènent artistes et commentateurs à proclamer toutes les six semaines la mort de la peinture, du théâtre, du roman, de la musique, de l’art en général. Kasimir Malevitch, John Cage ou Marcel Duchamp ont fait de cette proclamation des événements artistiques indéfiniment répétés depuis. Moustacher la Joconde et nous révéler qu’L.H.O.O.Q., élever une cuvette de chiotte au rang d’objet d’art et de motif à commentaires savants, c’est un plan d’évasion, presque une clef pour sortir de l’épuisement où parvient forcément un jour un art axé sur lui-même et des œuvres figurées comme des hypostases du dieu Marchandise. C’est rappeler que tout art tient d’abord dans un événement social, des regards qui se croisent, se nouent et transforment la vision du monde. Mais le geste salutaire de Duchamp (comme l’interminable bégaiement de ses épigones) ne suffit pas encore. Il est encore prisonnier d’un regard en arrière qui le condamne à la ponte d’une œuvre-marchandise. Le système le sait. Il le prouve. Il s’en vante. Sûr de son fric, il nous lance, goguenard: «J’ai acheté un Duchamp.» D’un appel d’air, il fait une valeur refuge. Un croisement de regard termine sa destinée dans la nuit d’un coffre-fort. Et dans cette obscurité, «le» Duchamp multiplie la mise de son nouveau maître. Le système a subverti la subversion, passé la laisse, laissé la provocation bénéfique en suspens.
00:05 Publié dans internet, travail, vraie vie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
04 juin 2006
ma nuit de chouette
 Est-il un moment plus pénible, dans la vie d'un oiseau de bureau, que le réveil ? Avant même que vous n'ayez ouvert les yeux, alors que vous retardez le plus possible ce premier mouvement fatidique, piquent sur vous tous vos collègues oiseaux dont vous allez sans tarder retrouver les têtes familières. Untel aura mis une cravate à mickeys jaunes, telle autre sera venue en amazone ou en méduse, aucun d'entre eux ne parlera la langue commune aux oiseaux du ciel.
Est-il un moment plus pénible, dans la vie d'un oiseau de bureau, que le réveil ? Avant même que vous n'ayez ouvert les yeux, alors que vous retardez le plus possible ce premier mouvement fatidique, piquent sur vous tous vos collègues oiseaux dont vous allez sans tarder retrouver les têtes familières. Untel aura mis une cravate à mickeys jaunes, telle autre sera venue en amazone ou en méduse, aucun d'entre eux ne parlera la langue commune aux oiseaux du ciel.
Il fera jour. Les lumières électriques seront allumées tout de même, les néons au plafond passeront leurs tics nerveux aux êtres et aux choses, et le gargouillis de la machine à café imitera les derniers râles d'un agonisant. Ce sera un jour comme un autre, le dernier que vous pourrez supporter en tout cas, le premier, ou presque, d'une longue série qui devrait logiquement se terminer par votre mise à la retraite rapidement suivie de votre mort.
C'est tout cela que vous entrevoyez avant même de voir quoi que ce soit sinon les méandres tantôt noirs et blancs tantôt colorés qu'un projecteur intérieur trace sur l'écran de vos paupières, avant même que l'inconscience vous congédie et vous charge de nouveau du pénible poids de vos membres et de vos pensées.
Il fait jour. Votre corps, au fur et à mesure qu'il est rendu au monde diurne, s'alourdit considérablement au point de devenir impossible à mouvoir, il faudrait une grue, il faudrait tout le savoir des anciens Égyptiens pour soulever ne fût-ce qu'un doigt de cette gisante monumentale, de cette masse chaude et immobile, de cette déesse salariée à tête de hibou victime d'une paralysie générale, des ongles aux cils.
Il fait jour.
Comment refermer le cratère qu'on a ouvert en bâillant ? Il ne faut surtout pas croire qu'on est seul à voyager dans un cube transparent, à ne pas pouvoir étendre les jambes, déplier la colonne vertébrale, s'étirer et faire craquer ses os. Les dimensions de la vie ont été mal calculées, le mètre divin était sans doute faussé, il n'y a de place ni pour faire la roue, ni pour s'élancer, ni pour courir. Se mettre debout, ce n'est pas la peine d'y penser, mais avec un peu de force et d'énergie, et à condition d'entrer la tête entre les épaules, on peut tenter de demeurer accroupi.
Il fait beau.
Le jour n'a pas une apparence hideuse : blond et maigrichon, il obéit à des ordres supérieurs.
Il faudrait pouvoir se laver, mais la salle de bains s'est éloignée déraisonnablement pendant la nuit, la pomme de douche pend, défendue, à une distance infranchissable. Je la regarde sans cligner des yeux, jusqu'à ce que des larmes remontent de réservoirs cachés. Oiseau triste, je tente une toilette de chat à l'eau salée.
Le temps passe.
Alors qu'il est trop tard déjà depuis longtemps, que tous les autres oiseaux ont quitté leurs nids familiaux, que leurs enfants sont déjà livrés aux maîtres chanteurs, leurs cafés au lait bus, leurs peaux douchées et frottées énergiquement, puis enduites de lait hydratant, que, sentant le parfum de marque, ils se sont déjà enfermés ponctuellement dans leur prison de jour, je me lance, sans espoir de réussite, à leur poursuite.
Quand j'arrive enfin, exténuée, hagarde, ils sont déjà alignés sur leur barre et me regardent passer, certains se vernissent les griffes d'un rose transparent, d'autres sifflent d'un air réprobateur, tous ont quitté la nuit dans laquelle je suis plongée, ma nuit de chouette qui ne me quitte pas, qui n'enferme que moi.
Il faut alors aller chercher, quelque part au-delà de cette nuit et avant que ne commence le néant, en quelque endroit improbable et lointain, les forces herculéennes qui me permettront de prononcer les mots « bonjour » et « ça va ? ». Une fois cet exploit accompli, une fois le fond de la mine atteint et vidé de ses dernières ressources naturelles, le reste n'est plus qu'une longue attente, et le soir finit toujours par arriver.
Anne Weber, Chers oiseaux, chapitre XII et XIII, p. 35-39
00:10 Publié dans littérature, travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
03 juin 2006
oiseaux de bureau
 Chers oiseaux était le titre d'un morceau de prose sur la vie de bureau que j'ai écrit il y a quelques années, quand j'échangeais encore beaucoup de temps contre peu d'argent, et que cet échange était pour moi une souffrance quotidienne. Chers oiseaux était une lettre envoyée de la cage, une lettre d'adieu adressée à mes coprisonniers qui allaient rester derrière les barreaux. Une fois la lettre d'adieu terminée, j'ai donné ma démission.
Chers oiseaux était le titre d'un morceau de prose sur la vie de bureau que j'ai écrit il y a quelques années, quand j'échangeais encore beaucoup de temps contre peu d'argent, et que cet échange était pour moi une souffrance quotidienne. Chers oiseaux était une lettre envoyée de la cage, une lettre d'adieu adressée à mes coprisonniers qui allaient rester derrière les barreaux. Une fois la lettre d'adieu terminée, j'ai donné ma démission.
écrit Anne Weber dans Cendres & Métaux (Seuil, 2006, p. 51)
Cela donne une petite fable sans prétention mais très réjouissante sur le travail de bureau.
Citons le dernier chapitre, une lettre d'adieu qui se termine comme un roman de Philip K. Dick :
L'adieu aux oiseaux.
Chers vautours, chères vautourelles, chers amis colibris,
le moment est venu de nous quitter. Vous avez toujours été bons pour moi, aussi tenais-je à vous remercier. Quand j'avais des monceaux de bêtises sur le bout de la langue, vous m'avez bâillonnée scrupuleusement. Quand les bras me démangeaient, pales d'hélice frémissantes, vous m'avez ligotée soigneusement, de peur que je ne me fasse mal. Quand ma voix menaçait de geler, vous l'avez endormie à coups de verveine. Vous avez été méchants pour que je connaisse la méchanceté. Vous avez été bêtes pour que je n'ignore pas la bêtise. Vous avez été mesquins, vous avez été tristes, vous avez été sordides pour mon seul enseignement. Petits soldats de l'abrutissement et du devoir, vous m'avez montré la meilleure manière de crever le temps sans se crever. Vous m'avez appris qu'une journée peut tenir debout grâce aux courants d'air.
Je vous regardais. Vous étiez occupés à voir venir. Les coursiers arrivaient et repartaient, la machine à photocopier crachait triait recto verso recommençait, amalgamant vos visages jusqu'à ce que, sous la lumière des néons, l'immeuble entier s'ébranle et s'active dans une cadence frénétique afin d'oublier à tout prix le silence, et le prix du silence.
Chers oiseaux qui trimez depuis toujours et qui sans doute trimerez encore quand le soleil sera éteint et que les étoiles ne seront plus qu'un souvenir, je vous dis aujourd'hui adieu sans rancune ni repentir. Vous m'avez sauvé la vie.
Je vous regardais. Et j'ai enfin compris ce que vous aviez à me dire. Vous me disiez : Nous sommes morts.
Anne Weber, Chers oiseaux (Seuil, 2006, p. 77-78)
01:05 Publié dans littérature, travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
02 juin 2006
littérature fantastique

Citer la Bible me remet en mémoire cette citation de Jorge Luis Borges :
Je crois en la théologie comme littérature fantastique. C’est la perfection du genre.
(Conversations à Buenos Aires, avec Ernesto Sabato)
Borges qui a aussi écrit :
Il s'était déjà entraîné à simuler qu'il était quelqu'un, afin qu'on ne découvrît pas sa condition d'être personne.
(L'auteur et autres textes)
00:05 Publié dans citations, sf | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
01 juin 2006
fragilité des fragilités
Benasayag évoque également (p. 201) le célèbre début du livre biblique assez atypique et quasi oriental de L'écclésiaste (Qohélet) : traduit en général par « Vanité des vanités, tout est vanité », il pourrait également être rendu par le moins moralisateur : « Fragilité des fragilités, tout est fragilité ».
Dans la Bible de Jérusalem , une note précise en effet que « Le terme dont nous gardons la traduction traditionnelle "vanité" signifie d'abord "buée", "haleine", et fait partie du répertoire d'images (l'eau, l'ombre, la fumée, etc.) qui décrivent dans la poésie hébraïque la fragilité humaine. »

Citons pour le plaisir la suite du Prologue de L'écclésiaste :
Vanité des vanités, dit Qohélet ; vanité de vanités, tout est vanité.
Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil ? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, il tourne, tourne et va, et sur son parcourt retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler.
Toutes les paroles sont usées,
personne ne peut plus parler ;
l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit
et l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend.
Ce qui fut, cela sera,
ce qui s'est fait se refera,
et il n'y a rien de nouveau sous le soleil !
[…]
Moi, Qohélet, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai mis tout mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une mauvaise besogne que Dieu a donnée aux enfants des hommes pour qu'ils s'y emploient. J'ai regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil : eh bien, tout est vanité et poursuite de vent !
Ce qui est courbé ne peut être redressé,
ce qui manque ne peut être compté.
Je me suis dit à moi-même : Voici que j'ai amassé et accumulé la sagesse plus que quiconque avant moi à Jérusalem, et, en moi-même, j'ai pénétré toute sorte de sagesse et de savoir. J'ai mis tout mon cœur à comprendre la sagesse et le savoir, la sottise et la folie, et j'ai compris que tout cela aussi est recherche de vent.
Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin ;
plus de savoir, plus de douleur.
00:10 Publié dans citations, conscience | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
31 mai 2006
un rêve les yeux ouverts
Concernant les illusions de la conscience, Benasayag cite Gilles Deleuze :
Il ne suffit pas de de dire que la conscience se fait des illusions : elle est inséparable de la triple illusion qui la constitue, illusion de la finalité, illusion de la liberté, illusion théologique. La conscience est seulement un rêve les yeux ouverts.
(Spinoza et le problème de l'expression, Minuit, 1968, p. 204)
et précise :
 Notre conscience, à son tour, n'étant en rien conscience d'un mode extérieur, n'est, dans le meilleur des cas, qu'un appareil d'analyse (pas très fiable) qui n'intervient qu'une fois le phénomène advenu, c'est-à-dire en retard, et comme une partie, elle aussi, du phénomène. Partie du phénomène, la conscience - on n'insistera jamais assez - a pourtant tendance à se prendre pour la totalité et joue un rôle majeur dans la fabrication de la croyance, sorte d'autopromotion, d'après laquelle elle occuperait une place « extérieure » à l'ensemble dont elle ferait, tout compte fait, (humblement) partie.
Notre conscience, à son tour, n'étant en rien conscience d'un mode extérieur, n'est, dans le meilleur des cas, qu'un appareil d'analyse (pas très fiable) qui n'intervient qu'une fois le phénomène advenu, c'est-à-dire en retard, et comme une partie, elle aussi, du phénomène. Partie du phénomène, la conscience - on n'insistera jamais assez - a pourtant tendance à se prendre pour la totalité et joue un rôle majeur dans la fabrication de la croyance, sorte d'autopromotion, d'après laquelle elle occuperait une place « extérieure » à l'ensemble dont elle ferait, tout compte fait, (humblement) partie.
(La fragilité, p. 76-77)
00:50 Publié dans conscience | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
30 mai 2006
la plus grave maladie du cerveau

... c'est de réfléchir.
(petite devise shadok pour ponctuer mon 100ème post)
23:05 Publié dans cerveau, citations, travail | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
29 mai 2006
corps étrangers
Benasayag opère par exemple un rapprochement intéressant entre notre conscience (illusoire) d'être un moi unitaire et le fonctionnement de nos mécanismes immunitaires.
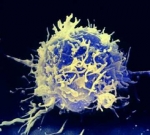 Encore plus étonnants peuvent paraître certains mécanismes visiblement très éloignés de la conscience et de la mémoire, comme ceux relevant de l'immunologie. Comment est-il posible que nos anticorps, nos mécanismes immunitaires soient capables de reconnaître des corps étrangers à notre corps ? Quelles sont donc les bases de l'unité d'un corps , d'une colonie de cellules, ou de la colonie de fourmis dont nous parlions plus haut ? L'idée qu'il existerait, par exemple, un « soi » immunologique est au moins aussi intéressante ou mystérieuse que celle selon laquelle il y aurait une individuation psychique. [...]
Encore plus étonnants peuvent paraître certains mécanismes visiblement très éloignés de la conscience et de la mémoire, comme ceux relevant de l'immunologie. Comment est-il posible que nos anticorps, nos mécanismes immunitaires soient capables de reconnaître des corps étrangers à notre corps ? Quelles sont donc les bases de l'unité d'un corps , d'une colonie de cellules, ou de la colonie de fourmis dont nous parlions plus haut ? L'idée qu'il existerait, par exemple, un « soi » immunologique est au moins aussi intéressante ou mystérieuse que celle selon laquelle il y aurait une individuation psychique. [...]
Or l'unité immunologique ne relève pas d'une simple distinction entre le soi et le non-soi comme s'il s'agissait là de deux entités à tenir à l'écart. Le système immunitaire est un système éminemment dynamique, qui se maintient en permanente interaction interne, recevant sans arrêt des stimuli qui proviennent de lui-même. Ainsi, quand une molécule étrangère n'est pas reconnue comme ayant la « carte du club », elle interfère, tout simplement, dans le fonctionnement du système lymphoplasmocytaire. Ne pouvant interagir avec le système qu'elle aura pénétré, la molécule étrangère sera interprétée comme du « bruit » dans le système. [...]
Ainsi, dans l'exemple du fonctionnement du système immunitaire, il n'y a pas une réaction de feedback directe avec un corps étranger, mais un rapport au fonctionnement intérieur, au modèle autonome, lequel, une fois dérangé, essaiera de rétablir sa stabilité. Ce qui constitue l'élément central dans le mécanisme immunitaire, c'est le caractère autoréférentiel de son fonctionnement, le fait que la réaction immunitaire n'est pas le résultat d'une action que l'organisme déclenche pour se défendre d'un hôte indésirable (cela, c'est le récit en extériorité), mais la conséquence d'un automatisme du système qui cherche en permanence à garder, ou à rétablir, sa stabilité par une série de comportements simples du type essai/erreur, parmi lesquels peut ou non émerger la bonne « réponse ». [...]
Le système immunitaire se comporte donc de façon similaire à celle décrite par Varela au sujet du système nerveux central : « Il ne recueille pas mais impose une information à l'environnement. »
(La fragilité, p. 109-111)
Encore faut-il préciser que ces mécanismes immunitaires si efficaces parfois se dérèglent. Nos cellules tueuses alors se retournent contre nos propres cellules pour nous détruire, encore plus sûrement, quoique plus silencieusement, que les mécanismes (plus ou moins) conscients par lesquels nous sommes capables de nous détruire psychologiquement.
01:15 Publié dans conscience | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note


